la fecondation
2 مشترك
Hamza_artist :: ؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤{ ♥ المنتديات التعليمية ♥ }¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛ :: منتدى العلوم الطبية ، البيولوجيا و البيطرة
صفحة 1 من اصل 1
 la fecondation
la fecondation
Embrylogie
2.1. Définition
La fécondation est la fusion du gamète mâle avec le gamète femelle.
Cette fusion aboutit à la formation d'une cellule unique : le zygote (ou
embryon de stade 1 cellule). Elle a lieu dans l'ampoule de l'oviducte chez les
mammifères et dans l'infundibulum chez les oiseaux. La fécondation est donc
précédée par la libération de l'ovule : c'est la ponte ovulaire ou ovulation et
la libération des spermatozoïdes ou éjaculation. La rencontre des deux gamètes
s'opère à l'issue d'une insémination naturelle appelée aussi accouplement (ou
coït) ou à l'issue d'une insémination artificielle (in vivo dans le tractus
génital de la femelle ou in vitro en "éprouvette"). Chez la plupart
des mammifères, si la rencontre n'a pas lieu endéans les heures qui suivent
leur libération, les gamètes dégénèrent (tableau 2.1.)
Généralement, l'ovule non fécondé dégénère après quelques heures. Le
spermatozoïde a une durée de vie équivalente ou légèrement supérieure avec
quelques exceptions notées en gras. Dans le cas de la chauve-souris, cette
fécondation différée est une adaptation au climat des zones tempérées. Les
accouplements s'effectuent en automne et en hiver mais l'ovulation et la
fécondation au printemps (i.e. Pipistrellus pipistrellus)
(1) La période de fécondabilité de l'ovule est plus importante chez la chienne
car l'ovocyte expulsé doit réaliser ses deux divisions de maturation.
car ces individus sont
dépourvus d'oviducte, d'utérus et de la partie supérieure du vagin (figure
2.11).
Un autre cas de pseudohermaphrodisme mâle se rencontre chez les Schnauzers
nains qui présentent des testicules atrophiés et cryptorchides, des conduits
mâles et femelles, un pénis normal et une gynécomastie. Ce type de
pseudohermaphrodisme mâle est dû à un défaut d'AMH ou du récepteur de cette
hormone. Le tractus génital se masculinise sous l'action des androgènes mais
l'absence d'AMH ou de son récepteur entraîne la persistance des canaux de
Müller et de ses dérivés (oviductes, utérus, partie crâniale du vagin).
2.5.1.3.6. L'inversion sexuelle
Une inversion sexuelle s'observe lorsque le sexe génétique est l'opposé du sexe
gonadique et phénotypique. Le cas le plus fréquent concerne les mâles XX. Ils
résulteraient d'une translocation sur le chromosome X de la région du
chromosome Y portant le gène Sry. Ce gène code pour un facteur de transcription
qui est le "commutateur primaire" (main switch) de la détermination
du sexe mâle. Ces mâles XX sont cependant stériles parce que la seule présence
du gène Sry ne semble pas suffisante pour assurer le développement complet du
tractus génital mâle.
Les femelles XY sont plus rares (figure 2.11). Elles résulteraient d'une
mutation ponctuelle du gène Sry qui rend le facteur de transcription inactif ou
d'une délétion du fragment du chromosome Y portant le gène Sry. Elles sont
également stériles.
Il existe cependant au moins deux espèces de mammifères chez lesquelles on
observe l'existence physiologique de femelles XY fertiles : le lemming des bois
(Myopus schisticolor) et le lemming variable de l'Arctique (Dicrostonyx
torquatus). Les mâles sont normaux (XY).
Chez la première espèce, il existe 3 types de femelles (cf. figure 2.14) :
a) les femelles normales XX dont la sex-ratio des jeunes est de 1
 : 1¢.
: 1¢. b) les femelles XX* dont un chromosome sexuel (X*) porte un gène qui inactive
l'action de masculinisation du chromosome Y. La sex-ratio des jeunes est de 3

: 1¢.
c) les femelles X*Y dont la sex-ratio des jeunes est de 4
 : 0¢ et qui donc ne
: 0¢ et qui donc neproduisent que des femelles. Il a été démontré que chez les femelles X*Y, le
chromosome Y est activement éliminé chez les cellules germinales et que le
chromosome X* est dédoublé par non-disjonction. Tous les ovules produits sont
donc porteurs du chromosome X*. Fécondées par un mâle XY, ces femelles X*Y
donnent naissance à des femelles X*Y et XX*.
Chez le lemming variable de l'Arctique (Dicrostonyx torquatus), il existe
également trois types de femelles (figure 2.15) : les XX normales, les XX* et
les X*Y mais à la différence de l'espèce précédente, les femelles X*Y
produisent des mâles normaux XY. L'explication la plus plausible suggère que le
chromosome Y n'est pas éliminé et que ces femelles produisent donc des ovules
X* mais également des ovules Y. S'ils sont fécondés par un spermatozoïde Y, le
développement du zygote YY s'arrête précocement car la présence d'un chromosome
X est indispensable au développement embryonnaire. Par contre, fécondés par un
spermatozoïde X, ces ovules Y mènent à la naissance d'un mâle normal XY.
Remarque : dans la littérature, le terme d'inversion sexuelle est également
utilisé pour désigner les processus de protogynie et de protandrie, les cas
d'hermaphrodisme et de pseudohermaphrodisme où le sexe phénotypique est franchement
affirmé (mâle ou femelle) et opposé au caryotype sanguin (XX ou XY) et même les
cas de transsexualité (espèce humaine).
2.6. Les anomalies par mutation de
l'ADN mitochondrial
Les mitochondries, souvent désignées comme les "centrales
énergétiques" de la cellule, possèdent leur propre ADN et se répliquent
par elles mêmes. L’ADN mitochondrial (ou mtADN) contient l’information pour la
synthèse de 13 polypeptides, sous unités d'enzymes-clé du métabolisme
énergétique (cytochrome c oxydase, ATPase,...); 22 ARN de transfert (ou tARN)
et 2 molécules d’ARN ribosomial (ou rARN). Comme elles sont indispensables à la
survie cellulaire, une anomalie de l'ADN mitochondrial peut avoir des
conséquences dramatiques pour l'individu. Les affections du génome mitochondrial
provoquent surtout des encéphalo-myopathies (maladies neuro-musculaires) et
plus rarement des troubles pancréatiques, hématopoïétiques et optiques (maladie
de Leber ou atrophie optique à hérédité maternelle). Les deux processus
responsables de ces affections du génome mitochondrial sont la délétion et la
mutation ponctuelle. Généralement, ces mutations sont hétéroplasmiques car
elles ne concernent qu'une partie de la population de mitochondries. La
sévérité des troubles cliniques dépendra de la nature de la mutation et de la
proportion des mitochondries mutées. Une mutation homoplasmique porte, elle,
sur toutes les mitochondries (ex. maladie de Leber). Lorsque ces affections
sont héréditaires, elles reconnaissent le plus souvent une origine maternelle
puisque les mitochondries paternelles sont éliminées peu après la fécondation.
Dans la plupart des cas, ces affections mitochondriales sont sporadiques et
résultent d'une mutation de novo.. Enfin, certaines délétions mitochondriales
sont suspectées de participer au processus de la sénescence de l'individu car
la proportion de mitochondries anormales passe de 1/100.000 chez le foetus à
1/1.000 chez l'adulte.
Beaucoup de mutations de l’ADN mitochondrial n’engendrent aucun trouble. Ces
mutations neutres sont très étudiées pour reconstituer l’arbre phylogénétique
d’une espèce. En effet, le mtADN évolue, mute plus vite que l’ADN génomique.
Son “ horloge moléculaire ” tourne plus rapidement, ce qui permet d’étudier
l’évolution génétique d’une espèce au cours de périodes de temps réduites, de
l’ordre de 5 à 100.000 ans (par comparaison à l’horloge moléculaire de l’ADN
génomique, plus adaptée à des périodes de l’ordre de plusieurs millions
d’années). Il faut cependant retenir que la précision de ces horloges
moléculaires est théorique car il semble que toutes les parties d’un génome
(mitochondrial ou nucléaire) ne varieraient ni à la même vitesse, ni de façon
constante !
2.7. Les hybrides
Un hybride est un animal dont les parents appartiennent à deux espèces
distinctes mais proches sur le plan taxonomique (même genre). Généralement, ces
hybrides sont stériles car ils héritent de leurs parents deux compléments
génétiques suffisamment différents pour empêcher la méiose de leurs cellules
germinales de s'effectuer, mais suffisamment semblables pour permettre leur
développement embryonnaire. L'exemple le plus connu est l'hybride obtenu par
croisement entre le cheval (Equus caballus) et l'âne (Equus asinus). Le mulet
(ou la mule) est le produit d'une jument et d'un âne et le bardot celui d'une
ânesse et d'un étalon. Il existe de nombreux autres exemples d'hybrides chez
les mammifères (et davantage chez les oiseaux). Le tableau 2.5 reprend quelques
exemples d'hybrides rencontrés chez nos mammifères domestiques.
 رد: la fecondation
رد: la fecondation
جزاكم الله خيرا
[/URL]http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=8
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4408
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4399
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=27
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=25
[/URL]http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?cat=8
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4408
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-...ge_id=4399
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=27
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/inst-gtu/?page_id=25
Hamza_artist :: ؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤{ ♥ المنتديات التعليمية ♥ }¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛ :: منتدى العلوم الطبية ، البيولوجيا و البيطرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى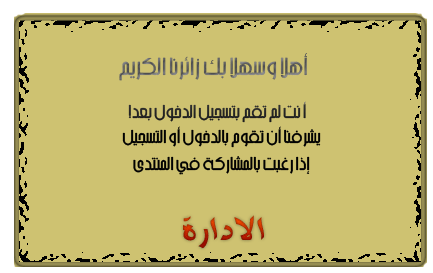










 عدد مشآرڪآتي:
عدد مشآرڪآتي: نْـقٌٍـآطُْـيَـے•
نْـقٌٍـآطُْـيَـے• تاريخ التسجيل :
تاريخ التسجيل : 


